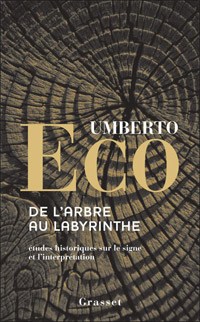Qui ne connaît pas Umberto Eco ? Son livre Le nom de la rose et l’adaptation cinématographique qui en suivit ont porté son nom à la connaissance du grand public. Et pourtant, Eco n’est pas romancier de profession. Il est universitaire, ou plus précisément sémioticien, c'est-à-dire spécialiste du signe et de ses interprétations. Le dernier livre qu’il vient de faire paraître en France entre dans cette catégorie d’écrits.
Il s’agit d’un recueil d’articles et de conférences produits depuis les années 70, témoin privilégié du parcours universitaire de leur auteur. A ces quelques mots combien d’entre vous songent déjà à fuir ? Vous auriez tord ! C’est qu’il y a dans ce livre plus qu’une simple étude pesante et ennuyeuse. Umberto Eco est un véritable érudit. Curieux de tout, il sait communiquer sa passion à son lecteur, pour peu que ce lecteur aime, lui aussi, glaner quelques pépites de l’histoire de la pensée (souvenons-nous que l’intrigue du Nom de la rose part d’un livre d’Aristote !).
Ce livre est une mine de curiosités. Vous y croiserez pêle-mêle arbres, labyrinthes, chiens, Dante, Peirce, Kant et bien sûr Aristote… Vous y trouverez bien entendu toute la rigueur universitaire que l’on est en droit d’en attendre, mais avec un je ne sais quoi de plus qui sort cet ouvrage de la gangue jargonnante et précieuse qui vous laisse sur le pas de la plupart des livres de ce type. Encore faut-il se laisser emporter par son charme qui, je dois l’avouer, a complètement œuvré sur moi.
"Mais quel cheminement mène de l’arbre au labyrinthe ?", seriez-vous en droit de me demander. C’est un changement de régime de signe dont témoigne la première partie éponyme du livre. Chez les médiévaux, le modèle de l’arbre est le modèle descriptif privilégié hérité d’Aristote. Définir un mot consistait à remonter les ramifications de l’arbre pour expliciter les idées présentent en chacun de ses nœuds (modèle que nous continuons à exploiter de nos jours en généalogie). L’idée que désigne le mot contient en elle, analytiquement, les propriétés qu’il va falloir mettre au jour. L’homme par exemple, est défini comme animal bipède. Les idées d’animalité et de bipédie définissent de manière absolue l’idée d’homme. C’est ce type de définition que développent les dictionnaires qui apparaissent alors.
Le modèle du labyrinthe correspondra, lui, à celui de l’encyclopédie d’apparition plus tardive : une errance perpétuelle dans un univers de signes qui se renvoient les uns aux autres sans s’épuiser, sans donner une explication définitive. La compréhension n’est plus affaire d’accès à l’universalité d’une idée, mais d’orientation dans ce dédale. Vient ensuite un nouvel univers de signe, celui du réseau : chaque point du réseau peut renvoyer à n’importe quel autre moyennant un parcours évoluant constamment et qui n’est plus figé dans une complexité définie. C’est le règne de l’hypertexte à l’ère internet, des boucles de renvoi infini qui permettent de sauter d’une référence à une autre. Ces trois modèles ont une apparition temporelle marquée, et vont articuler une histoire du signe.
Dans la suite du livre se mêleront différentes références qui témoignent du contexte intellectuel des différentes époques. De l’incompréhension de la notion de métaphore aristotélicienne par Averroès aux débats de théologiens qui se disputaient autour de la question de l’aboiement du chien (entre intelligence manifeste de l’animal domestique et cris d’apparence vide de sens) ; de la pratique de la falsification au Moyen-Age à la recherche d’une langue universelle articulant une pensée pure ; de Peirce (fondateur de la sémiotique contemporaine) au silence de Kant (incapable, apparemment, de penser la question du signe)… Autant de connaissances que le gourmet, amateur d’érudition, saura picorer et qui témoignent d’un pan de l’oeuvre d’un grand penseur.