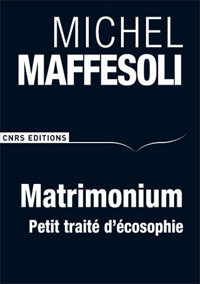Drôle d’objet que ce petit livre que nous propose Michel Maffesoli... Drôle d’objet pour un drôle de nom : l’écosophie. De quoi est-il question dans ces soixante-dix neuf pages ?
L’auteur nous présente son ouvrage comme une invitation à "prendre conscience qu’un autre esprit du temps est en gestation". Quel esprit ? Et pour prendre quelle place ? Celle d’un rationalisme qui, prenant le relais du texte biblique, a conduit à un mythe du Progrès, fondateur de la modernité et dont nous voyons aujourd’hui les limites. Ce fut l’apogée de la technique dont le projet fut formulé par Descartes "devenir comme maître et possesseur de la nature". Mais ce projet ne représentait qu’une nouvelle instanciation du texte biblique qui décrivait dans la genèse un homme mis en position, par son créateur, de dominer la terre et les animaux. Mythe du Progrès qui désormais s’essouffle et entre en phase de déclin. Faut-il pour autant paniquer ? Michel Maffesoli ne le pense pas : "le déclin est l’indice d’une nouvelle genèse", genèse dont les linéaments sont posés dans ce Petit traité d’écosophie.
Ce nouvel esprit, à la différence du "progressisme" dont il vient prendre la place, ne scinde plus. A une pensée de l’opposition nature/homme, ainsi que d’une opposition des individus entre eux se substitue une recherche d’unité, une "invagination du sens", retour à l’essentielle nature des choses. L’écosophie est cette tendance qui ne parvient pas encore à se théoriser mais qui s’installe pourtant dans notre rapport quotidien au monde. Il n’y est pas question d’écologie, revendication politique qui reste encore dans cette logique de la séparation, mais bien d’une nouvelle manière d’être.
Drôle d’objet que ce livre à l’énergie débordante, à l’enthousiasme communicatif. Sans doute essentiel, en période de crise où le catastrophisme et le cynisme sont les maîtres mots, ce petit traité (très court et agréable à lire) permet d’ouvrir des horizons alors que tout semble bouché. Il y a dans ses pages un optimisme qui fait du bien en temps de grisaille, une invitation à penser le monde à nouveaux frais.
Ce travail est-il pour autant exempt de toute critique ? Difficile à catégoriser (mais est-ce là une critique ?), on ne sait pas vraiment d’où Michel Maffesoli nous parle. Il ne s’agit pas d’une rigoureuse (et pesante) étude sociologique (quand bien même l’auteur est sociologue professeur en université), il y aurait plus là une prospective philosophique qui restera encore à approfondir par la suite. Mais on peut se demander si cette prospective, tout en critiquant à juste titre le mythe du Progrès, ne se laisse pas prendre à un mythe de la pureté originelle de la nature qui est également courant en philosophie. Dans cette écosophie Michel Maffesoli ne se contente pas de décrire un phénomène en court, il l’appelle de ses vœux et abandonne par là la sacro-sainte neutralité du sociologue. En adoptant cette attitude, il ouvre une question qu’il n’affronte pas ici : comment fonder cette idée de pureté sans remplacer un mythe par un autre ?
Critique qui ne doit pas détourner de l’essentiel : ce livre est un appel à penser, et il y réussit fort bien. "Ces lignes s’adressent à ceux qui ne se contentent pas d’écouter mais savent entendre" nous avertit l’auteur. Sortir d’une lecture avec des questions en tête et des doutes, c’est en sortir grandi. Il faut savoir gré aux personnes qui acceptent de nous prendre sur leurs épaules.