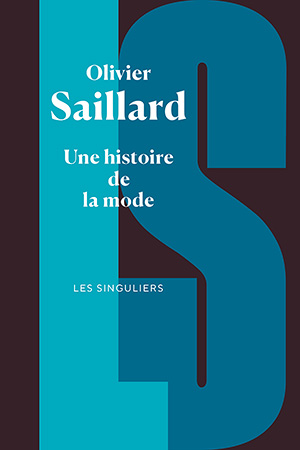Lire la mode : quand les mots habillent le monde
Peut-on écrire la mode comme on la porte ? Peut-on la lire comme un roman, l'imaginer sans image, la rêver à travers des phrases ? À la Fondation Alaïa, le philosophe italien Emanuele Coccia et le curateur, écrivain et historien Olivier Saillard ont dialogué autour du nouveau livre de ce dernier, Une histoire de la mode (éditions Bouquins). Un ouvrage manifeste : un livre de mode sans images, où l'écriture devient un acte de création et de résistance.
Olivier Saillard, le couturier des mots
Autodidacte et poète du vêtement, Olivier Saillard a bâti son oeuvre entre mémoire et invention. Historien de formation, il a longtemps observé la mode avant de la pratiquer. Dès ses débuts, l'écriture a précédé le geste : "J'ai d'abord écrit", confie-t-il. Cette écriture de la mémoire est devenue son fil rouge : un outil de résistance à l'oubli et à la répétition.
Formé à l'histoire de l'art, Saillard rédige ensuite un mémoire consacré à la relation entre art et mode. Ce double ancrage, intellectuel et sensible, guide toute sa démarche. De ses années de conservateur au Palais Galliera jusqu'à sa direction actuelle de la Fondation Azzedine Alaïa, il a toujours cherché à réconcilier les mots et les vêtements, les corps et leurs traces. "J'aime ce que la mode contient de fané, de caché, les vêtements que l'on choisit de garder", dit-il.
Une histoire de la mode sans images
Avec Une histoire de la mode, Saillard poursuit cette quête. Le livre s’inscrit dans la lignée des publications anciennes du XVIIIe et du XIXe siècle, lorsque les magazines de mode étaient avant tout des revues littéraires, peuplées de descriptions minutieuses, parfois signées d’hommes écrivant sous pseudonyme féminin. "Je regrette que les magazines et livres de mode soient devenus des catalogues d’images", avoue-t-il.
En rééditant les textes fondateurs des Bouquins de la mode, il propose un retour à la lecture : lire la mode plutôt que la regarder ou la consommer. Ce geste est autant esthétique qu’éthique. Décrire un vêtement, c’est en faire exister la mémoire. L’inventaire devient poème, la liste devient liturgie. Les mots, comme les étoffes, conservent la trace des corps disparus.
L’acte révolutionnaire d’écrire la mode
Face à Emanuele Coccia, philosophe du sensible et du vivant, Saillard revendique la radicalité du verbe : "Écrire la mode, c’est déjà un acte révolutionnaire". Dans un univers saturé d’images, l’écriture redevient un espace de résistance, un geste de désobéissance.
Les références convoquées - Roland Barthes, Stéphane Mallarmé, Jean Genet, Martin Margiela - dessinent un panthéon d’auteurs pour qui le vêtement n’est jamais anodin. Barthes parlait d’une géographie du langage et de la mode, Mallarmé décrivait avec minutie les tenues, Margiela déconstruisait le vêtement jusqu’à le rendre concept. "Qu’est-ce qu’un créateur après Margiela ?" interroge Saillard. "Peut-être rien", sinon l’idée même de la mode. C’est là que Saillard se situe : dans un territoire où le vêtement n’existe plus que par les mots, comme Yves Klein faisait exister la peinture par le geste.
Une mode invisible, faite de mots
Saillard évoque l’une de ses performances les plus marquantes : SOS, imaginée avec Violeta Sanchez. Sur scène, dans une économie totale de moyens, l’ancienne égérie de Mugler et d’Helmut Newton prête sa voix et sa présence à une mode devenue invisible. Elle décrit des vêtements qu’on ne voit pas, répond à des questions absurdes, "entre dans le corps Mugler", "quitte celui de Cavalli", murmure "Google" comme nom de maison de couture. Tout y est jeu de langage, satire et poésie.
Présenté comme un atelier de désentoilage, le happening agit à la fois comme parodie et exorcisme : il déshabille les vanités de l’industrie, détourne les codes du défilé pour n’en garder que la parole nue. Les tissus y deviennent métaphores, les épingles des mots, les coutures des silences. Dans ce théâtre minimal, la mode se fait écriture pure, un art de l’évocation où le verbe remplace la matière et où le corps devient le support d’une langue sensible, à la fois ironique et bouleversante.
Une mode "faite de mots", où le corps devient texte et l’imaginaire, tissu. Dans cette perspective, l’histoire de la littérature et celle de la mode se confondent : toutes deux hantées par l’apparence, la disparition, la trace. Chez Saillard, l’écriture tient lieu de couture : elle relie ce qui a été défait.
 Coccia, philosophe du visible et de l’invisible
Coccia, philosophe du visible et de l’invisible
Face à lui, Emanuele Coccia apporte une résonance philosophique. Habitué du dialogue entre pensée et création, il est déjà familier de la mode : en 2023, il cosignait avec Alessandro Michele, alors directeur artistique de Gucci (actuellement chez Valentino), La Vie des formes. Philosophie du réenchantement, un essai qui explore la beauté comme principe vital, la mode comme métaphysique du visible.
Avec Saillard, il partage cette conviction que les vêtements ne sont pas des objets, mais des milieux vivants. Ils habitent nos gestes, façonnent nos relations, traduisent notre manière d’exister.
Les muses, les cahiers, la fidélité aux mots
Saillard, fidèle à sa pratique d’écriture, note tout. Ses cahiers, remplis de dates, de poèmes et de fragments, sont des inventaires du temps. "J’écris beaucoup et mal", dit-il en riant. Adolescent, il osait une écriture illisible, comme pour protéger son intimité ; aujourd’hui, il garde cette habitude. Inspiré par Catherine Pozzi, il imagine un livre sur les muses, ces présences silencieuses qui inspirent la mode autant que la poésie.
Un art sans rien vendre
"Il faut repenser et renouer avec la mode à travers les mots. Faire de son art un travail qui ne vend rien."
Cette phrase, prononcée presque en conclusion, résume toute sa position : la mode comme un art affranchi du commerce, de la possession, du marché. Une mode où la beauté retrouve sa fonction première : révéler le monde plutôt que le décorer.
Crédits photos : Paola Simeone, avec l'aimable autorisation de la Fondation Azzedine Alaïa