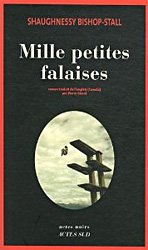"L'écriture c'est comme le poker. Il faut de la patience, de la concentration, de l'endurance, de la cohérence" énonce Mason Dubisee qui pense avoir la vocation de l'écriture.
Mais comme il perd toujours au poker, il ne parvient pas davantage à s'atteler utilement à l'écriture d'un roman se limitant à quelques rares billets publiés dans de vagues feuilles de chou ou sur le Net.
Il faut préciser que sa barque est plutôt "chargée" : impulsif, compulsif, cyclothymique, anxieux, suicidaire, capable d'actes incontrôlables, il tend sévèrement vers la psychose maniaco-dépressive avec des accès d'anxiété, de peur panique et de dépression.
Par ailleurs, il carbure avec un cocktail journalier implosif à raison de 84 verres d'alcool et 4,5 grammes de cocaïne, sans compter les extras en médicaments qui, s'il s'agit d'une stratégie de l'échec, est particulièrement bétonnée. Si non, son pronostic vital à court terme est compromis au point que personne ne miserait un dollar sur son avenir.
D'autant que sans un sou et criblé de dettes de jeu, sans domicile fixe, sans travail et sans grande volonté d'en trouver, il ne doit sa survie qu'à un copain d'enfance, gangster et dealer, qui le dépanne régulièrement tout en le maintenant dans ses addictions.
Et pourtant, à l'aube de ses trente ans, cet anti-héros personnage principal de "Mille petites falaises", le premier roman de Shaughnessy Bishop-Stall, prend la décision de se reprendre en main.
Plus facile à dire qu'à faire mais l'important est déjà d'en avoir acté le principe et de faire le deuil de ses illusions, ou du moins de celui qu'on a été qui ne sera plus jamais et tout le monde sait que le sursaut salutaire n'intervient qu'après avoir touché le fond.
Pour Mason dont la dérive est déjà bien amorcée, exorciser ses démons prend naturellement le chemin d'une descente aux enfers qui commence de manière rocambolesque à la manière de Donald Westlake par la vente de hot-dogs à des névrosés et la reconversion en scribe moderne pour contemporains suicidaires recrutés via son site "vers la sortie.com" et s'achève par un thriller gore à la Thomas Harris en passant par une traversée psychiatrique et la fulgurance de l'amour.
Descente aux enfers mais également chemin de croix pour "une grâce salvatrice", titre du dernier chapitre, pour ce conte moderne quasi judéo-chrétien dans lequel la rédemption n'intervient après la confrontation victorieuse mais non sans graves dommages collatéraux avec l'incarnation humaine du mal absolu qui, en l'espèce, porte le nom d'une redoutable divinité guerrière de la mythologie égyptienne.
Pour son premier opus littéraire, dont le titre original "Ghosted" rend davantage compte de l'odyssée du héros devenu nègre et fantôme de lui-même au pays de ceux qui se sont perdus, puisant sans doute dans ses investigations journalistiques dans les bas-fonds de Toronto et son thésaurus autofictionnel, Shaughnessy Bishop-Stall brosse un saisissant conte moderne quasiment judéo-chrétien dont tient à sa rythmique qui, même si elle n'est pas novatrice, est bien maîtrisée.
En effet, considérant que "c'est juste plus amusant d'être capable de sortir votre boîte à outils entier comme un écrivain et d'utiliser tous les bits, plutôt que de simplement s'en tenir à un point de vue ou la tonalité", il pratique un syncrétisme efficace qui tient au mélange des genres pour peindre un monde malade en perte de repères associé à la rupture de la linéarité narrative par l'insertion de notes, de lettres, de mails et de flashs rétrospectifs et la récurrence des outils de thérapie cognitive que sont les listes et le questionnaire Socrate dans le traitement des psychoses.
Ce qui donne à sa prose, par ailleurs largement ancrée dans le post-modernisme américain, un aspect labyrinthique et catalytique qui peut laisser accroire qu'il s'agit d'un voyage davantage psychique que réel menant à la connaissance de soi, ce qui le rapprocherait de la pérégrination initiatique au coeur du roman gothique, ce qui enrichit encore l'intérêt de sa lecture.