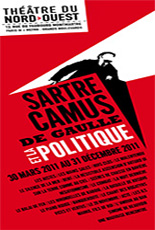Drame de Jean-Paul Sartre, mise en scène de Odile Malet et Geneviève Brunet, avec Frédéric Almaviva, Michel Baladi, Axel Beaumont, Olivier Carette, Philippe Celo-Bayard, Marta Corton Viñals, Lionel Fernandez, Vincent Gauthier, louise Lemoine-Torrès et Jean-Luc Jeener.
Jean-Paul Sartre fait partie des intellectuels inscrits aux abonnés absents de la résistance intellectuelle pendant la seconde guerre mondiale, qui ont, subitement après 1945, fait partie de la Commission d’épuration de la librairie et de l’édition et eu l'illumination de la responsabilité de l'intellectuel dans son temps.
Et en 1948, année où il rejoint le groupe qui sera à l’origine du Rassemblement Démocratique Révolutionnaire prônant un socialisme révolutionnaire et démocratique pour créer une troisième voie de gauche entre la SFIO et le PCF, il consigne ses états d'âme philosophico-politiques et autofictionnels sur les arcanes intellectuels de l'engagement politique dans "Les mains sales".
Ressortissant simultanément au théâtre de situation, à la tragédie et au drame historique et ponctuée de scènes de comédie, voire de vaudeville, que les metteuses en scène Odile Malet et Geneviève Brunet ont su habilement tisser, sans verser dans l'excès illustratif, cette pièce sur toile de fond d'un passé immédiat, surabonde en thématiques duelles.
Bien évidemment, la dichotomie entre la théorie et l'action contingente, entre l'idéalisme absolu et le pragmatisme matérialiste, dichotomie à laquelle Sartre n'apporte pas de solution mais résout de manière spécieuse par une consonance métaphysique en miroir des personnages archétypaux qui en représentent les deux pôles, le partage ardu entre la conviction et l'opportunisme politique, la finalité du parti révolutionnaire, demeurer une force d'opposition ou exercer le pouvoir et l'organisation interne du parti qui reproduit la stratification sociale qu'il se donne pour mission d'anéantir.
Mais également la philosophie existentialiste, la conception sartrienne de la liberté et la problématique de l'acte gratuit déjà balisée en 1914 par André Gide dans "Les caves du Vatican" et Albert Camus en 1942 dans "L'étranger".
En l'espèce, pendant la seconde guerre mondiale, dans un pays monarchiste fictif d'Europe centrale demeuré indépendant, qui s'est gardé de la tentation nazie mais est menacé d'une défaite face à la Russie contre laquelle il est entré en guerre, un jeune intellectuel bourgeois idéaliste, en rupture idéologique avec son milieu et en quête d'authentification existentielle, a intégré un parti révolutionnaire dans lequel il ronge son frein dans des activités de bureau souhaitant être engagé dans l'action sur le terrain.
Profil idéal pour lui confier la mission de tuer une des figures de proue du parti considérée par certains cadres dirigeants comme un social-traître en ce qu'il négocierait une participation à une coalition gouvernementale.
Mais la mission s'avère difficile à mener pour le jeune Hugo, soudainement confronté aux doutes et errements qui altèrent son image romantique du héros salvateur qui délivrera le monde de l'oppression et du mensonge, face à Roederer, homme dont la stature, la maturité politique et la force de persuasion font plus que le déstabiliser.
Odile Malet et Geneviève Brunet mènent leur troupe avec rigueur dans une scénographie simple qui joue sur les fondus-enchaÎnés.
La distribution est excellente et tous les comédiens incarnent parfaitement la dualité intime de la plupart des personnages, fonctionnant quasiment en binôme janusien, qui sont toujours, de manière plus ou moins consciente et malhonnête, en négociation subjective entre leurs convictions et les contingences de la réalité et dont l'intérêt personnel qui, s'il ne prime pas toujours le bien commun, sert de curseur.
Tels Frédéric Almaviva, diplomate souple comme un roseau dans le rôle du souverain habitué à manoeuvrer sur l'échiquier politique, et Vincent Gauthier, représentant véhément du parti majoritaire qui se voit imposer de prendre en considération les revendications des minoritairesSi Lionel Fernandez et Olivier Carette campent des militants qui ne s'embarrassent pas de sentiment, dans le rôle des plébéiens que la nécessité à amener à se mettre au service du parti selon un schéma contractuel qui n'impliquent qu'une adhésion idéologique formelle, Michel Baladi et Philippe Celo-Bayard jouent les gardes du corps de Roederer avec un humour "décompressif".
Axel Beaumont, parfait dans l'aveuglement candide et l'obstination délétère du jeune Hugo, et Jean-Luc Jeener, impressionnant de maîtrise et de conviction dans celui de Roederer, se taillent la part du lion dans les scènes de confrontation, sous entendues ou explicites, d'une tension et d'une violence particulièrement intenses dans lesquelles Sartre instillent des répliques qui font mouche du fait notamment de son sens de la formule.
De surcroît des formules à la résonance intemporelle par le vrai débat d'idées qu'elles suscitent telles : intellectuels ne sont pas des révolutionnaires, ils sont tous juste bon à faire des assassins", "Les hommes, tu les détestes parce que tu te détestes toi-même, ta pureté ressemble à la mort et la Révolution dont tu rêves n’est pas la nôtre : tu ne veux pas changer le monde, tu veux le faire sauter", "Un parti, ce n’est jamais qu’un moyen. Il n’y a qu’un seul but : le pouvoir" et le mythique "Moi j’ai les mains sales. Jusqu’aux coudes. Je les ai plongées dans la merde et dans le sang. Et puis après ? Est-ce que tu t’imagines qu’on peut gouverner innocemment ?".
Dans ce monde d'hommes, deux femmes, Louise Lemoine-Torrès convaincante en muse politique et Marta Corton Viñals particulièrement subtile dans la fraîcheur aguicheuse et tentatrice de Jessica, la jeune épouse d'Hugo, par lesquelles Sartre révèle en l'occurrence une conception de la femme pour le moins sexiste.
Non seulement ce sont par elles que la tragédie se noue et se dénoue - la première pour vouloir faire de son favori un héros, la seconde pour être l'instrument de l'ironie tragique qui conduit celui-ci au passage à l'acte - mais leur comportement serait toujours affecté par un déterminisme sexuel - la passionnaria allant jusqu'à travestir sa motivation amoureuse en raison politique - face à un homme qui seul peut les transfigurer en les révélant à elles-mêmes
Ainsi la frivole Jessica, pour laquelle la vie, dorée, n'est qu'un petit jeu sans conséquence, accède à l'humanité grâce à la seule présence messianique de Roederer ("J’ai vécu dans un songe et quand on m’embrassait ça me donnait envie de rire. À présent je suis là devant vous, il me semble que je viens de me réveiller et que c’est le matin").
Donc à voir absolument dans le cycle Sartre, Camus, De Gaulle et la Politique du Théâtre du Nord-Ouest.